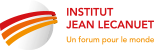L'avenir de l'Etat providence : l’effondrement politique de l’État providence grec
Cinquième intervention du colloque "L'avenir de l'État providence en Europe". L'ensemble des interventions sera publié sur notre site, rubrique "Actualités". Ce colloque était organisé par le Cercle de Belém et l'institut Jean Lecanuet, le 2 décembre 2015, au palais du Luxembourg.
La question que chacun se pose sur la Grèce est simple : pourquoi ce pays ne parvient-il pas à se relever de la crise, alors que l’Irlande, le Portugal et d’autres pays ont adopté des programmes qui ont, eux, porté leurs fruits ? Quel est le problème ?
Pour les Grecs, l’Etat providence remonte à Aristote, pour qui l’État est une mimêsis de la nature. Cette dernière reste, pour eux, à la fois ce qui les protège de l’extérieur et une sorte de daimon intérieur, à l’instar de celui de Socrate. Porter la production et la concurrence à un point tel qu’il leur faut sacrifier des valeurs naturelles comme l’amitié, la famille ou le « bien vivre » provoque des réactions violentes de nature économique, mais aussi culturelle. Les Grecs refusent de se voir imposer un style de vie qu’ils apprécient moins. Bien sûr, la Grèce possède un taux de consommation très élevé. Ce paradoxe ne doit pas être éludé.
Les Grecs se décomposent plus ou moins en deux catégories. Les riches échappent à tous les contrôles fiscaux en changeant de nationalité : ils préfèrent payer leurs impôts à l’étranger plutôt qu’en Grèce. Seuls paient leurs impôts les citoyens ordinaires – travailleurs et retraités.
Dès lors, la dette publique est insurmontable. Elle s’apparente d’ailleurs à une forme de chantage à la réforme. Cela n’est pas nécessairement un mal. Toutefois, les deux grands groupes politiques utilisent cet argument populiste.
Le parti de centre droit de Antonis Samaras convient que les réformes sont salutaires pour la Grèce. La gauche, actuellement au pouvoir, promeut, au contraire, l’idée que toutes les mesures menées sont opposées à l’intérêt du peuple et à l’identité nationale grecque. La droite traditionnelle, plus naturellement encline aux thèses patriotiques, se révèle moins nationaliste que la gauche actuelle, dont les positions sont extrêmement proches de celles de l’extrême droite. Le gouvernement Tsipras comprend de fait un parti de gauche et un parti populiste.
L’Union européenne propose un système économique, au prix de sacrifices, pour redresser l’économie de certains pays. La réaction à cette politique des deux grands partis grecs est en tous points opposée. L’un consent à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux règles. L’autre s’y refuse au motif que la Grèce y perdrait sa souveraineté et son identité. Ce dernier discours est très séduisant pour les Grecs, frappés de plein fouet par la crise.
La Grèce souffre d’un déficit de valeurs politiques. Les partis politiques atteignent des niveaux de populisme comparables à ceux du XXe siècle en Russie. Une telle situation n’est naturellement pas propice aux réformes structurelles dont le pays a besoin.
Au début de la crise, le gouvernement allemand a demandé à la Grèce de mettre en œuvre plusieurs réformes de nature économique et sociale. Il a été convenu de prendre les mesures demandées, comprenant notamment des baisses de salaire considérables. Au parlement, Alexis Tsipras nous a accusés de vendre la Grèce à l’Allemagne. Nous avons fait valoir qu’à défaut nous risquions de nous voir imposer des mesures encore plus drastiques. Un artifice constitutionnel très simple a alors été employé pour provoquer des élections et une campagne démagogique et populiste a permis à Alexis Tsipras de se faire élire. Quand les fonds confiés à la classe politique disparaissent sans qu’on en connaisse la destination, il est naturel que la population développe un sentiment de défiance à son égard.
Après avoir longtemps dénigré Angela Merkel, Alexis Tsipras s’est ravisé aussitôt après son élection et clame avoir « appris », ce qui ne traduit pas une grande conscience politique. Alexis Tsipras est récemment rentré de sept mois de débats au Parlement européen, à Bruxelles, en n’ayant rien gagné, au contraire : le troisième mémorandum est encore plus drastique que les précédents.