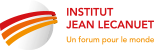L'avenir de l'État providence en Europe : l'expérience italienne - du miracle à la crise, de la crise à la réforme
Quatrième intervention du colloque "L'avenir de l'État providence en Europe". L'ensemble des interventions sera publié sur notre site, rubrique "Actualités". Ce colloque était organisé par le Cercle de Belém et l'institut Jean Lecanuet, le 2 décembre 2015, au palais du Luxembourg.
Depuis plus de vingt ans, l’État providence italien s’est révélé incapable de répondre aux besoins d’une société en profonde mutation. Alors que l’Italie voyait émerger de nouvelles réalités comme le travail temporaire, les parcours de carrière discontinus, les familles recomposées ou le travail posté, tous impossibles à concilier avec la garde des enfants ou les soins aux aînés, le régime de protection sociale est demeuré bloqué, orienté vers les besoins d’hommes et de femmes relevant d’anciennes catégories de risque. Du coup, dans le contexte du ralentissement économique des quinze dernières années, les dispositifs de redistribution en place ont débouché sur un jeu à somme nulle où les travailleurs intégrés tirent leur épingle du jeu aux dépens de ceux qui ne le sont pas.
Cette rigidité date des années 1970, époque où l’Italie, grâce au "miracle économique" est parvenue au plein-emploi pour la première et unique fois de son histoire. La société italienne ne s’est pas ajustée sans mal aux réalités économiques créées par cette croissance économique aussi imprévue. Pour citer l’analyse incisive des historiens Nicola Rossi et Gianni Toniolo, "les capitalistes italiens, pris au dépourvu par le plein-emploi, se révélèrent lents à s’adapter à ses conséquences politiques et sociales immédiates. Les organisations syndicales accrurent leur audience et consolidèrent leurs positions de négociation, mais n’étaient pas équipées idéologiquement et culturellement pour utiliser leurs pouvoirs fraîchement acquis à encourager la croissance, plutôt que de pousser à des changements drastiques et immédiats dans la distribution des revenus."
Dans une telle situation, les tentatives pour mettre en œuvre les réformes institutionnelles qui auraient pu faciliter le processus de transition et préparer le pays aux futurs défis se sont révélées difficiles à concrétiser. Dans cette fragile démocratie d’un pays passé par vingt ans de fascisme et deux ans de guerre civile, et confronté aux menaces terroristes, les gouvernements ont recouru à la dépense publique comme instrument pour apaiser les conflits sociaux et obtenir le consensus politique.
Dès 1975, les dépenses consacrées aux transferts sociaux atteignaient 19,6 % du PIB, plaçant l’Italie au troisième rang pour les dépenses de protection sociale en pourcentage du PIB parmi les pays industriels occidentaux – derrière la France. Cette époque a également vu l’introduction d’une véritable bombe à retardement dans le budget de l’État, avec la mise en place d’un régime de retraite basé sur les revenus, tant pour les emplois publics que privés, système qui nécessitera ensuite vingt ans pour se réformer.
Le climat politique tendu de cette période et une croissance économique de l’ordre de 6 % ont poussé les gouvernements et les partenaires sociaux à poursuivre une politique que l’on peut qualifier d’apaisement. Les grandes industries, comme l’automobile, la chimie et l’acier, ont été concentrées dans les mains de quelques grands groupes, aidés par les gouvernements sous la forme de ce qu’on appelle aujourd’hui le capitalisme de copinage. Des avantages fiscaux et juridiques ont été accordés aux PME, de même qu’une série d’autres avantages, comme des restrictions à l’importation et, après la crise pétrolière, des dévaluations compétitives. La part dévolue aux employés a consisté en une série de réglementations portant sur l’organisation du travail et sur le système de rémunération. En particulier, un statut des travailleurs, approuvé en 1970, a renforcé la force de négociation des salariés et introduit de sévères restrictions au recrutement comme au licenciement.
Ainsi, après plus d’une décennie de croissance alimentée par une élasticité élevée de l’offre d’emploi, le plein-emploi et les conflits idéologiques et politiques ont donné un coup d’arrêt à l’économie italienne. L’Italie a continué de croître jusqu’aux années 1990. Toutefois, avec l’avènement de la mondialisation, ces relations du travail sclérosées, une dépense publique extravagante et une productivité stagnante ont largement contribué à désarmer le pays face aux nouveaux défis.
L’historien britannique Asa Briggs a donné cette définition restée célèbre de l’État providence : un État au sein duquel le pouvoir organisé est utilisé de manière délibérée afin de modifier le jeu des forces de marché et réduire ainsi diverses formes d’inégalité. Les deux théories sociales prédominantes de l’ère républicaine, c’est-à-dire la théorie catholique et la théorie marxiste, étaient particulièrement sensibles à un tel message. En conséquence, la culture, l’idéologie et les intérêts économiques ont conspiré pour faire de l’État providence italien un enchevêtrement inextricable de droits acquis. Le sentiment de lassitude à l’égard de l’économie de marché qui prévalait il y a quarante ans n’est pas moins vrai aujourd’hui.
J’ai commencé il y a trois ans à travailler sur le traitement des thèmes économiques dans la littérature italienne contemporaine, motivé par l’importance très forte des sujets économiques dans le paysage littéraire italien. L’industrie de l’édition a soutenu cette mode en accordant le plus prestigieux prix littéraire du pays à Edoardo Nesi, ancien entrepreneur, pour son roman autobiographique Storia della mia gente (Histoire de mon peuple).
Storia della mia gente raconte l’histoire du déclin de l’industrie textile à Prato. Edoardo Nesi en fait une parabole de la crise économique de l’ensemble du pays. Il suggère que la crise industrielle italienne est essentiellement due à des facteurs exogènes, comme l’adoption de l’euro et l’avènement de la mondialisation. Il atténue la responsabilité des hommes d’affaires comme lui-même, qui ont négligé de se préparer à des défis pourtant annoncés depuis longtemps, comme le montre la recherche en sciences économiques. Cette période pendant laquelle l’Italie a gaspillé une prospérité durement acquise est malheureusement devenue l’objet de plus en plus de discours politiques nostalgiques. Les arguments du "J’accuse" de Edoardo Nesi sont partie intégrante du débat politique et se retrouvent dans les programmes des partis populistes comme le Mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord.
En Italie comme ailleurs, les réformes ne peuvent survenir qu’au prix d’un changement d’interprétation des liens unissant l’individu et l’Etat. Un changement culturel de cette ampleur est difficile à obtenir dans un pays qui fait preuve d’un attachement idéologique et émotionnel à son passé récent. Toutefois, l’approbation par le Parlement du Jobs Act a constitué un grand pas en avant vers une réforme des règles du jeu. La question est de savoir s’il sera suffisant.
Le Jobs Act est à l’origine une tentative pour combattre l’insécurité des jeunes dans le monde du travail, avec notamment le phénomène du "précariat". Il vise aussi à réduire la judiciarisation des relations du travail. Il n’est pourtant pas une vraie réponse au chômage des jeunes, qui atteint 40 % en Italie, car le chômage ne peut être combattu que par la reprise économique. Une plus grande flexibilité dans le marché du travail est une condition nécessaire, mais non suffisante au redressement.
La dernière mouture du projet de loi préserve la possibilité pour les employeurs d’embaucher de manière temporaire et de renouveler les contrats jusqu’à cinq fois au cours des trois premières années. Les employeurs bénéficient ainsi d’un délai plus long avant de convertir le contrat temporaire en un nouveau contrat de travail, ce dernier conférant davantage de protection.
La coexistence de plusieurs types de contrats va à l’encontre de l’un des principes de base du Jobs Act, c’est-à-dire un processus d’apprentissage et d’investissement mutuel des employeurs et des employés pendant la période d’essai. En conséquence, l’Italie enregistre une hausse des enregistrements de sociétés, travailleurs et employeurs cherchant tous deux à contourner la multiplicité des contrats existants. Les indépendants représentent 23 % de l’emploi total, soit près de 10 % de plus qu’en Allemagne ou en France – un chiffre qui va à l’encontre de la culture italienne et suggère une contrainte plutôt qu’un choix.
Certains observateurs ont émis l’hypothèse que le succès rencontré par le nouveau contrat dans les mois suivant son introduction tiendrait aux abattements fiscaux qui l’accompagnent. En somme, le Jobs Act constitue certainement une innovation bienvenue dans les relations de travail en Italie, mais il est loin d’être la panacée décrite par la propagande gouvernementale. Il ne favorise guère les jeunes travailleurs, qui se trouvent toujours plus à l’écart dans une économie encore en stagnation.
La liste des réformes nécessaires reste encore longue, à commencer par celle du secteur de l’éducation. S’il est vrai que les leçons de l’histoire se présentent comme des chocs, l’histoire a déjà fait son œuvre en laissant toute une génération d’Italiens connaître le pire déclin de leur prospérité en plus de cinquante ans. La leçon portera-t-elle ses fruits ?