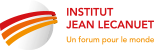![By Tânia Rêgo (Agência Brasil) [CC BY 3.0 br (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/deed.en)], via Wikimedia Commons By Tânia Rêgo (Agência Brasil) [CC BY 3.0 br (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/deed.en)], via Wikimedia Commons](https://institutjeanlecanuet.org/sites/default/files/media/media/manifestacao_no_rio_de_janeiro_contra_corrupcao_e_o_governo_dilma_em_13_de_marco_de_2016_1.jpg)
Brésil : une instabilité politique chronique
Le Brésil, le plus grand État de l’Amérique latine avec 206 millions d’habitants, connaît de nouveau une crise politique majeure.
Le favori des sondages à la prochaine élection présidentielle qui doit se tenir à l’automne, Luiz Inácio Lula da Silva, dort depuis le 7 avril à la prison de Curitiba. La raison : l’achat sans justification financière d’un appartement de trois pièces à Rio de Janeiro, vraisemblablement “offert” par une entreprise de travaux publics. Un enrichissement sans cause, sans doute réel, mais une “miette” dans l’océan de corruption qui gangrène le pays. Un piège, ou une naïveté, pour les amis de l’ancien président, dans lequel ce dernier est tombé à l’automne d’une vie militante au service des luttes sociales. La sanction est double : douze ans de prison ferme et une martiale déclaration du commandant en chef des forces armées menaçant le pays d’une prise de pouvoir par les militaires. Un goût de déjà vu dans ce pays, sujet de manière régulière à des accès de fièvre et à la tentation du coup d’État militaire.
LA PERMANENCE D'UN POPULISME DE DROITE. Le 4 octobre 1930, la “vieille République” des États-Unis du Brésil et son dernier président, Washington Luís Pereira de Sousa, étaient renversés par une révolte populaire soutenue par une mutinerie “des lieutenants” dans les casernes. Il s’agissait de mettre un terme à la mainmise des grands propriétaires caféiers sur la vie politique brésilienne. Cette révolution était menée par deux forces politiques : les moyens propriétaires fonciers désireux de se concilier et de s’appuyer sur les couches populaires, d’une part, les militaires, officiers de second rang et sous-officiers, soucieux d’une reconstruction nationale empreinte d’efficacité technocratique, d'autre part. Une coalition qui associait droite populaire et droite technicienne.
Le symbole de ce “fascisme à la brésilienne”, c'est Getulio Vargas (1882-1954), président de la République de 1932 à 1945, puis de 1950 à 1954.
En 1937, Vargas proclame “l’Estado Novo”, l’État nouveau, un régime autoritaire qui s’inspire du régime de Salazar au Portugal et qui prône une réforme modernisant l’État, du travail des femmes à la création d’un Institut de la statistique, de la manufacture de tabac, réglementant la vente d’alcool. Il s’appuie sur un parti unique, appelé curieusement Parti travailliste brésilien, qui se veut de gauche, mais se rapproche en fait du péronisme argentin. Pour les politologues brésiliens, le régime de Vargas était un régime corporatiste de droite. Après deux tentatives manquées, en 1932 et 1937, il fut destitué en octobre 1945 par les militaires, des généraux qui composèrent leur propre gouvernement en majorité composé d'anciens “lieutenants” de la révolution de 1930. Mais Vargas retrouva le pouvoir cinq ans après. En effet, il fut démocratiquement élu au suffrage universel à l’élection présidentielle d’octobre 1950. Commençait alors une période plus démocratique, en apparence du moins. Vargas conduisit une politique de grands travaux, nationalisa les ressources pétrolières, instaura des mesures protectionnistes et favorisa les réformes sociales, d’où le surnom de “Père des pauvres” qui lui fut donné par ses partisans dans les classes populaires. Mais sa lutte contre la droite conservatrice poussa des membres de la garde présidentielle à fomenter, en août 1954, l’assassinat d’opposants, ce qui amena le chef de l’État à mettre fin à ses jours, le 24 août 1954.
Les mouvements populistes d’extrême droite recèlent souvent en leur sein une “aile gauche” très sociale, se voulant même socialiste. Au Brésil, elle fut représentée par Joao Goulart, vice-président de la République en 1956 sous la présidence de Juscelino Kubitschek, puis sous celle de Jânio Quadros en 1961, avant de devenir lui-même président de la République à la démission de ce dernier. Il se lança dans une politique de nationalisation et de redistribution des terres agricoles, de nationalisation des mines, d’augmentation des salaires. Il inquiéta les grands propriétaires fonciers et l’administration américaine, fut accusé de communisme et finalement renversé par un coup d’État militaire le 31 mars 1964.
Le Parti travailliste brésilien, qui existe toujours, porte encore la lourde responsabilité d’avoir suscité les révoltes successives des militaires. Sa fibre sociale explique aussi pourquoi, survivant à tous ses échecs, il sera un soutien, en 2001, à la candidature de Lula da Silva aux élections. Il demeure, paradoxalement, membre de la coalition aujourd’hui au pouvoir.
LA VOLONTE DE REVANCHE DE LA DROITE CONSERVATRICE. Cette droite, très libérale sur le plan économique, conservatrice sur le plan social, démocrate sur le plan politique, a eu son heure de gloire entre 1889 et 1930, pendant la Ie République. Elle a été tenue à l’écart et a rongé son frein durant toute la seconde République, entre 1930 et 1964. Elle commit alors l’erreur de soutenir le coup d’État militaire de 1964, avant de se séparer des militaires.
Son grand homme fut Carlos Lacerda, emblématique gouverneur de Rio de Janeiro, un ancien journaliste devenu le grand adversaire de Getulio Vargas, aux méthodes discutables, prêt à tout pour parvenir au pouvoir, allant jusqu’à simuler un attentat contre lui-même. C’est lui qui fit chuter Vargas, accula Jânio Quadro à la démission en 1961 et encouragea le renversement de Joao Goulart en 1964. Mais les militaires n’avaient pas sorti l’épée du fourreau pour lui remettre le pouvoir. Dès 1966, il fut poussé hors du jeu politique. Son parti, le Parti social-démocrate brésilien, qui n’a de social que le nom - le Brésil n’est pas à un paradoxe près -, n’est jamais parvenu à occuper le pouvoir.
Aujourd’hui, le Parti social-démocrate espère être la solution à la corruption, un mal endémique au Brésil. Sa vision technocratique et élitiste de la société le pousse à considérer que la mauvaise gouvernance est due aux classes inférieures, avides de s’enrichir une fois au pouvoir. Les classes supérieures seraient, selon lui, suffisamment aisées pour mieux résister à la tentation. Il a réussi à s’imposer avec le président Fernando Cardoso, entre 1995 et 2003, qui sut rétablir la confiance dans la monnaie brésilienne. Mais la droite conservatrice recèle aujourd’hui d’autres forces.
En effet, la longue période de la dictature militaire connut des évolutions entre les généraux issus des écoles et ceux issus du mouvement “des lieutenants” de 1930 : ces derniers voulurent conduire une trajectoire politique maîtrisée en suscitant des partisans et des opposants officiels au régime. Les partisans constituèrent le Parti de la rénovation nationale brésilienne et les opposants, le Mouvement démocratique brésilien (MDB), étrangement appelé centriste aujourd’hui.
Ce mouvement, opposant “officiel” au régime des militaires, donc toléré par ces derniers, a durement bataillé pour amener une transition démocratique. C’est lui qui a permis, avec les présidents Tancredo Neves et José Sarney, de ramener le Brésil vers les urnes et qui a favorisé, en 1990, l’élection du président de la République au suffrage universel. Comme le Parti travailliste brésilien, il est membre de la coalition au pouvoir et Michel Terner, son principal dirigeant, occupe la présidence.
Les multiples formations de la droite divergent du fait de leur origine idéologique, certaines remontant à la révolution de 1930, d’autres se référant à la Ie République. Cependant, elles ont une même vision libérale de la politique économique à conduire et la même vision conservatrice de la politique sociale.
LA GAUCHE BRESILIENNE. La gauche brésilienne a ceci de particulier qu’elle est née du mouvement ouvrier et non du mouvement socialiste qui n’a jamais existé. En effet, il n’y a jamais eu dans la bourgeoisie locale une existence d’un parti “de gauche”. La droite nationale omniprésente s’est scindée, divisée, déchirée sans qu'émerge une démocratie-chrétienne capable d’initier un centre puissant et de peser sur la vie politique, ou une gauche radicale, au sens premier du terme. Le mouvement franc-maçon a influé sur la droite conservatrice brésilienne, mais n’a jamais songé à développer une force politique réformatrice, cela ne permettrait pas a fortiori le développement d’un parti socialiste.
Cela explique l’origine sociologique de la gauche brésilienne. Il n’y avait au départ ni médecins, ni avocats, ni professeurs, ni haut-fonctionnaires dans les dirigeants de cette gauche. Lula da Silva a été tourneur dès l’âge de 14 ans, Dilma Rousseff, fille d’un communiste bulgare exilé en 1929, est une révolutionnaire professionnelle, ancienne guerillera, torturée dans les prisons militaires brésiliennes. Permanent syndical pour l’un, apparatchik activiste pour l’autre, ils ont appris la politique sur le terrain.
C’est ainsi à partir des syndicats nés de la lutte contre la politique économique de la dictature militaire que Lula da Silva, devenu président du syndicat de la métallurgie, créa en 1980 un Parti des travailleurs. Ce parti n’a jamais appartenu à l’Internationale socialiste. Il a intégré des trotskistes et a longtemps été classé à l’extrême gauche. Dès sa fondation, il a joué la carte de la transition démocratique souhaitée par le dernier président de la dictature, le général Figuerreido (1979-1985).
Libre de tout préjugé idéologique, il s’est même rapproché du MDB, pourtant intégré au régime militaire, mais favorable à la démocratisation, a noué des relations avec le Parti travailliste brésilien, héritier de Vargas dont on connaît les fréquentations idéologiques avec l’extrême droite. Patiemment, le parti des travailleurs a mené une campagne électorale permanente : Lula da Silva fut candidat à toutes les élections présidentielles au suffrage universel depuis 1990 et finit par l’emporter à sa quatrième tentative en 2002.
Cette première victoire s’inscrivait dans une perspective politique plus large en Amérique latine (Hugo Chavez au Venezuela, Rafael Correa en Equateur et Evo Morales en Bolivie). Malgré de grands espoirs, Lula eut la sagesse de s’entourer d’économistes chevronnés et permis ainsi la réussite d’une politique sociale audacieuse qui sortit plus de 30 millions de Brésiliens de la grande pauvreté mais qui resta compatible avec l’équilibre des finances. Le pays “décolla” littéralement sur le plan économique et acquis, sur le plan international, une aura toute nouvelle. L’idée du mouvement dit des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) doit beaucoup à son entregent. Il sut enfin préparer sa succession avec Dilma Rousseff. Mais le Parti des travailleurs n’est jamais devenu un “vrai” parti politique, il est demeuré une association d’entraide populaire, mi-mutuelle, mi-syndicale, et surtout un mouvement de gauche clientéliste. Un mouvement de plus en plus coupé des réalités sociales et éloigné des préoccupations quotidiennes des Brésiliens.
LA CORRUPTION ENDEMIQUE, CAUSE DE LA CRISE ACTUELLE. “Lula parle la langue du peuple parce qu’il comprend le peuple mieux que n’importe qui. Et la plupart de ceux qui ont cru un jour ont été tentés de croire de nouveau”, avait titré un journal brésilien. En réalité, la corruption a toujours miné la classe politique brésilienne. Elle n’a pas épargné la gauche. 2,4 milliards d’euros ont été “distribués” par la grande compagnie pétrolière Petrobras. Lula était soupçonné d’avoir amassé 7 millions d’euros. Une formule de transaction pénale qui permet des réductions de peines contre des aveux circonstanciés avait provoqué des aveux en cascade. Cela avait coûté indirectement sa place de présidente de la République à Dilma Rousseff, accusée d’avoir présenté un budget insincère.
Aujourd’hui, Lula da Silva est rattrapé par un dossier mineur. Les grands oligarques brésiliens, les médias, la grande bourgeoisie et la petite classe moyenne battent le pavé et tiennent leur revanche. Au contraire, un sentiment de trahison règne chez les ouvriers, les paysans, les chômeurs et les minorités ethniques. C'est que la magistrature a décidé, par un arrêt de la Cour suprême rendu par cinq voix contre cinq avec voix prépondérante de sa présidente, d’incarcérer sans délai Lula da Silva, âgé de 73 ans et atteint d'un cancer, pour douze longues années. Elle a décidé de mettre hors-jeu le Parti des travailleurs car le tribunal électoral refusera probablement de valider la candidature à l’élection présidentielle de Lula, qui n’avait pourtant pas épuisé toutes les formes de recours. S’il était resté libre, sa probable élection à la magistrature suprême aurait suspendu le processus judiciaire et les magistrats ne le voulaient à aucun prix. Le “pouvoir des juges”, comme en France, interfère donc aujourd’hui dans la vie politique brésilienne.
L’actuel président de la République, Michel Terner, est lui-même compromis dans une autre affaire et ne songe pas à briguer un autre mandat.
LA TENTATION MILITAIRE. Elle est inhérente à la vie politique brésilienne. Depuis 1889, c’est une succession ininterrompue de coups d’État militaires qui ont ébranlé le Brésil. L’indépendance même du Brésil, en 1822, est le fruit d’une révolte des casernes. La classe politique brésilienne n’a jamais eu la maturité suffisante qui aurait pu dramatiser un “pronunciamiento militaire”. Le coup de force apparaît toujours comme la solution ultime à un grand désordre.
En 1964, le régime de Joao Goulart était très controversé dans la rue. Lorsque les généraux brésiliens prirent le pouvoir le 31 mars, ils attendirent quinze journées pour écarter l’intérimaire Rainieri Mazzili au profit du maréchal Castelo Branco qui hésitait lui-même sur la pérennité du régime militaire. Il fut désavoué par ses compagnons d’armes en 1966 et son successeur, le général Costa e Silva fut déposé par un autre coup d’État militaire en 1969. Il fallut toute l'autorité et la lucidité du général Figuereido, entre 1979 et 1984, pour imposer le retour à un régime civil, conscient qu’il était du danger des dérives d’un régime prétorien.
Aujourd’hui, la situation est différente. Le temps s'est écoulé et a effacé bien des souvenirs. La corruption, en trente ans, a tout emporté. Déjà, en 1992, le flamboyant Fernando Collor, élu président de la République en 1989, avait dû se retirer devant la vague des scandales. L’élection d’un chef d’État au suffrage universel est toujours difficile, surtout dans une démocratie fragile. Elle suscite des espérances disproportionnées et conduit à de grandes déceptions. Un régime présidentiel, comme aux États-Unis, est équilibré par un Congrès politiquement tout-puissant.
En Amérique latine, comme en France, le régime est présidentialiste et le président de la République jouit de beaucoup de pouvoirs. C’est bien le cas au Brésil, à ceci près que le chef de l’État n’a aucune prise sur l’appareil militaire. Le pays vote majoritairement à gauche aux présidentielles, même si des “arrangements” obèrent la légitimité et l’équité aux élections du Congrès brésilien. La magistrature, conservatrice, n’aime pas la classe politique brésilienne, jugée très “nouveau riche” à droite et très “clan des parvenus” à gauche. Elle fait donc place nette… quitte à ouvrir la porte aux militaires.
Actuellement, les généraux brésiliens ne sont pas particulièrement attirés par le coup de force. Néanmoins, l’insécurité dans les favelas fait reculer la police, tentée quelquefois par des méthodes expéditives. De plus, les inégalités sociales restent très fortes. Récemment, la chaîne de télévision brésilienne TV Record News titrait sur l’expulsion d’une vieille dame de 73 ans, incapable de pouvoir payer son loyer, sans autre forme de relogement que la rue. Les efforts de la gauche brésilienne ont été stoppés net depuis la chute de Dilma Rousseff en mai 2016. L’armée craint aussi pour son budget et son indispensable modernisation dans un continent sud-américain devenu plus instable. En effet, Donald Trump est isolationniste et la “Pax americana” qui avait mis sous le boisseau les conflits territoriaux du XIXe et du début du XXe siècle est aujourd’hui bien lointaine. Depuis la chute du mur de Berlin, les régimes militaires ont disparu en Amérique latine, mais la démocratie entre droite conservatrice et gauche populiste peine à se conforter. La démocratie-chrétienne s’est considérablement affaiblie avec ses espérances d’un monde meilleur, possible et juste, aujourd’hui disparu.
Le Brésil s’est affirmé économiquement et a voulu devenir un géant international. Malheureusement, sa classe politique et ses élites dirigeantes n’ont pas été à la hauteur des enjeux. Trop souvent à droite, au service de l’oligarchie dominante sans en faire partie elle-même, ou à gauche, issue de milieux trop modestes pour résister aux tentations, la classe politique brésilienne manque de sens moral. Dans ces circonstances, la caste militaire se sent, à tort, investie d’une mission. Les mois qui viennent vont être tragiquement longs pour le Brésil et l’issue bien incertaine.