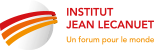![© United States Capitol - west front. Architect of the Capitol derivative work: O.J. [public domain]](https://institutjeanlecanuet.org/sites/default/files/styles/article_revue_header_image_1600x550/public/media/vignette/illustration_vincent_michelot-credit_united_states_capitol-_west_front_architect_of_the_capitol_derivative_work_oj_public_domain.jpg?itok=BvKwpdLn)
La présidence sans retour
Articles de la revue France Forum
Les partis politiques, les maillons faibles de la démocratie américaine.
La présidence américaine est une institution qui puise sa force dans la grande ambiguïté de la définition et de l’étendue de ses pouvoirs établis par la Constitution des Etats-Unis. Alors que le Congrès voit ses missions précisément définies et listées dans l’article 1 du texte organique, que la Cour suprême a, en quelque sorte, attendu le coup d’Etat constitutionnel de 1803 avec l’arrêt Marbury v. Madison dans lequel le haut tribunal s’auto-arrogeait le monopole du contrôle de constitutionnalité des lois (qu’il n’exercerait d’ailleurs vraiment que quelques décennies plus tard), la présidence, elle, a progressivement étendu ses pouvoirs, soit par une interprétation créative des « silences de la Constitution », soit par abandon de leurs prérogatives par les élus au Congrès, soit par renoncement des juges de la Cour suprême, soit, et cela a souvent été le cas depuis 1945, en se réclamant de l’urgence de la guerre ou d’une crise, internationale ou intérieure. Cette montée en puissance de l’exécutif américain, notamment en matière de politique étrangère et pour tout ce qui a trait à la fonction de « chef des armées » (commander in chief), s’est accompagnée d’une profonde transformation du rapport des partis politiques américains aux deux pouvoirs élus dans la construction de la décision publique : alors que l’affaiblissement progressif des Partis démocrate et républicain et la polarisation partisane rendaient les deux chambres du Congrès de moins en moins efficaces et productives et engendraient de longues périodes de paralysie institutionnelle, la présidence, elle, pouvait se nourrir de cet « hyper-partisanisme » qui lui permettait de mieux mobiliser lors des scrutins présidentiels et donc, dans une démocratie devenue plébiscitaire, de parler au nom du peuple face à un Congrès désuni, dysfonctionnel et rigide à l’extrême dans ses procédures. La combinaison de la mutation des partis et d’un système de contre-pouvoirs (checks and balances) qui s’exerçait de manière asymétrique contre le seul Congrès (les contre-pouvoirs face à la présidence étant, en quelque sorte, désarmés) est la principale explication de cette « impérialisation » de l’exécutif dont le récit commence dans les années 1960 et s’accélère au début du XXIe siècle avec les deux mandats de George W. Bush, dans l’ombre portée des attentats du 11 septembre 2001.
Ce nouveau rapport de force entre les trois pouvoirs de l’Etat fédéral a pour caractéristique de s’être construit de manière très incrémentale, progressive et dans une forme de négociation où, même à l’occasion d’un affrontement direct et parfois brutal entre Congrès et présidence, la Constitution l’emportait. Cela a été notamment le cas lors de la démission du président Richard Nixon en 1974 à la suite de l’affaire du Watergate. De même, George W. Bush a eu beau défendre la théorie de l’« exécutif unitaire » en s’appuyant sur l’urgence sécuritaire post-11 septembre, il n’est pas parvenu à accroître le pouvoir de la Maison Blanche dans des proportions significatives. Par conséquent, le cordon ombilical du politique américain qui lie le Congrès au président n’a jamais été coupé, ce qui a permis aux présidents successifs de continuer, souvent dans l’ombre, à travailler à l’adoption de leur programme législatif ou à préserver les intérêts vitaux des électeurs de leur parti. Le respect que l’un et l’autre des deux pouvoirs montrent pour les procédures et des codes institutionnels, l’adhésion au précédent et aux formes font que président et Congrès, même de couleurs politiques opposées, peuvent collaborer, quand bien même maladroitement. Par ailleurs, le président travaille d’autant mieux avec le Congrès, qu’il s’agisse de la majorité ou de la minorité, qu’il a servi son parti, contribué à l’armer dans le combat d’idées, aidé à le financer et à l’organiser. George W. Bush en est la parfaite illustration. L’impérialisation de la présidence a donc été consentie, négociée et encadrée par la Constitution. Elle s’est jouée aussi dans un contexte dans lequel le rôle de chef de parti du président américain s’est révélé déterminant.
POUR TRUMP : AUCUNE RÈGLE, TOTALE IMMUNITÉ. La présidence de Donald Trump a totalement déconstruit ce modèle de coopération dynamique entre les pouvoirs élus, essentiellement en désactivant préventivement tous les mécanismes de contrôle qui peuvent s’exercer sur l’exécutif et en faisant de l’élection le seul mode de contrôle de constitutionnalité acceptable. La productivité du Congrès se trouve en conséquence à son étiage puisque l’essentiel des réformes passe par le déploiement de la présidence administrative, le décret présidentiel étant devenu la procédure de référence en matière d’immigration, d’environnement ou de droit du travail ; le Congrès ayant refusé au président les crédits nécessaires à l’érection d’un mur à la frontière avec le Mexique, le chef des armées puise dans les crédits du Pentagone pour en lancer la construction. La décision, en juin 2019, de stopper à la toute dernière minute des frappes militaires sur l’iran après que la République islamique avait abattu un drone américain témoigne aussi du peu de cas que le président fait des protocoles de décision militaire, laissant dans l’ignorance son conseiller à la sécurité nationale, son ministre de la Défense et le vice-président, dans un moment fondateur pour la crédibilité de la diplomatie américaine. Plus généralement, le président Trump ne se considère astreint à aucune règle et ses conseillers juridiques déploient sur plusieurs fronts la même rhétorique selon laquelle un président en exercice jouirait d’une totale immunité en matière criminelle, poussant en quelque sorte à l’extrême le vieil adage nixonien qui veut que « si le président le fait, cela signifie que ce n’est pas illégal ». Cette immunité est encore mise à l’épreuve à la suite des révélations, en septembre 2019, d’un lanceur d’alerte selon lesquelles le président Trump, lors d’une conversation avec le président ukrainien, aurait conditionné le soutien des états-Unis au lancement par l’Ukraine d’une enquête sur le fils de Joe Biden, un possible concurrent en 2020. aussi graves soient ces accusations, et le dossier à charge s’est alourdi au fur et à mesure, les démocrates n’ont lancé une procédure de destitution (impeachment) qu’à reculons, contraints et forcés, et surtout parfaitement conscients de l’extrême risque qu’elle représentait. Pas un élu républicain d’envergure ne s’est clairement désolidarisé du président, au moins publiquement.
LES ÉLUS RÉPUBLICAINS ENTIÈREMENT SOUMIS. L’explication de cette passivité et du sentiment d’impunité qu’elle génère dans l’exécutif américain est simple : les élus républicains au Congrès sont entièrement soumis – certains diraient pris en otage – par la présidence. Le socle électoral du parti de l’éléphant est, en effet, composé d’admirateurs inconditionnels du président qui, bien que ne constituant pas la majorité du vote républicain, sont absolument incontournables dans la majorité des Etats lors des élections primaires et dont il est difficile de se passer lors des élections générales. Par conséquent, les élus modérés critiques de Donald Trump ont le choix entre la retraite et la défaite. A cela, il faut ajouter que, dans plusieurs domaines, l’immigration, la fiscalité, les questions religieuses, la politique menée par le président convient à une majorité de l’électorat conservateur qui souhaiterait simplement la voir mise en oeuvre sans les excès et les débordements polémiques. C’est donc la forme qui pêche plus que le fond. enfin, trois ans après la défaite humiliante de Hillary Clinton, le Parti démocrate, malgré quelques victoires symboliques lors des élections de mi-mandat de 2018, reste un parti en crise permanente, pour le moment incapable de proposer un autre modèle de société ou une stratégie électorale sur le long terme qui articule élections législatives et présidentielles.
Donald Trump a-t-il d’ores et déjà transformé en profondeur le paysage politique américain de manière irréversible ? il est beaucoup trop tôt pour le dire car l’on connaît la résilience des institutions américaines. On notera, cependant, que tous les épisodes précédents de crise constitutionnelle se sont déroulés dans un cadre partisan très structuré où démocrates et républicains offraient un cadre idéologique et organisationnel qui rendait plus aisée la navigation dans un espace constitutionnel mal cartographié. N’oublions pas, enfin, que Donald Trump n’est pas l’architecte de cette mutation : il a « simplement » eu le génie d’en percevoir les symptômes et les failles pour entrer – subrepticement – à la Maison Blanche dans les décombres d’un système partisan épuisé. L’avenir du système politique américain ne se joue ni au 1600 Pennsylvania avenue ni dans les méandres et silences de la Constitution, mais dans la capacité de deux grands partis politiques à se refonder.