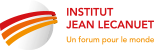« Vers une nouvelle donne politique ? », compte rendu
La bataille de la communication que se sont livrée les différentes familles politiques au soir des deux tours de l’élection départementale de mars 2015 n’a pas permis une lecture objective des résultats.
Celle-ci est pourtant nécessaire, ne serait-ce que pour imaginer, avec toute la rigueur voulue, les scenario possibles de l’élection présidentielle de 2017.
Yves Pozzo di Borgo. – Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour ce petit-déjeuner débat organisé par la revue France Forum. Créée en 1957, France Forum est rapidement devenu un lieu d’échanges entre les cultures de centre-gauche et les pensées démocrate-chrétienne et radicale. Cette revue trimestrielle avait alors une place importante dans la vie politique et intellectuelle. Après la Seconde Guerre mondiale, le but était d’en éviter une troisième en promouvant une logique européenne. Désormais, la logique est mondiale et nous orientons donc la revue vers l’internationalisation, sans oublier, comme c’est le cas aujourd’hui, de contribuer aussi à la vie de notre démocratie nationale.
Nous remercions vivement Xavier Chinaud, expert électoral, ancien conseiller pour les études politiques à Matignon, Jérôme Guedj, conseiller départemental de l’Essonne, et Édouard Philippe, maire du Havre, député de la Seine-Maritime, qui ont accepté d’être parmi nous ce matin.
Xavier Chinaud va nous présenter une étude sur laquelle Jérôme et Édouard Philippe seront invités à réagir.
Xavier Chinaud. – L’élection présidentielle de 2017 s’aborde dans le contexte de crise que nous connaissons tous :
- crise économique avec, aujourd’hui, des signaux qui montrent un grand risque de remontée des taux et l’absence d’autres relais de croissance ;
- crise de l’État avec un périmètre étatique réduit depuis trente ans par l’Europe et par la décentralisation, un Etat attaqué par la globalisation et affaibli par son inefficience. Il fait l’Europe à reculons et regarde insuffisamment le monde ;
- crise de la représentation : les représentants ont du mal à se représenter la société telle qu’elle est, disait le sociologue Pierre Rosanvallon, et cela semble de plus en plus vrai dans l’esprit des Français.
Les attentats de janvier dernier n’ont pas profondément changé la donne : seuls 14 % des Français font confiance aux partis politiques, 29 % aux syndicats et 30 % aux médias. 85 % pensent que les responsables politiques ne se préoccupent pas de ce que pensent les gens. Parmi les élus, seuls les maires sont épargnés (67 % de confiance). Enfin, 59 % ne font confiance ni à la gauche ni à la droite pour gouverner le pays. (Baromètre Cevipof/OpinionWay de la confiance politique, février 2015)
Dans ce contexte, penser l’élection présidentielle « à périmètre politique constant », décider de ne rien changer, poursuivre un jeu politique enfermé dans une logique de conquête du pouvoir plus que de son exercice, serait prendre un risque non négligeable, en 2017, d’éclatement de la société française.
Plutôt que de proposer une énième étude sur l’état de l’opinion à deux ans de l’élection présidentielle, nous avons choisi de nous interroger sur trois idées reçues, très répandues aujourd’hui, mais qui ne seront pas forcément la réalité en 2017. Mon opinion est que :
- le match annoncé François Hollande/Marine Le Pen/Nicolas Sarkozy est contestable ;
- la présence de Marine Le Pen au second tour est résistible ;
- les électorats FN-UMP, ou de droite en général, possèdent des porosités, mais également de vraies différences et des évolutions.
Observateurs et commentateurs convergent, aujourd’hui, sur l’idée que François Hollande sera le candidat naturel de son camp, que Nicolas Sarkozy remportera la primaire à droite et que Marine Le Pen sera incontournable dans la présidentielle de 2017.
Un certain nombre d’éléments vont en renfort de cette thèse : la Ve République a ses règles, dont celle qu’un président sortant qui souhaite se représenter s’impose dans son camp. On a connu ce cas de l’autre côté de l’échiquier. Concernant François Hollande, l’idée de lui imposer une primaire semble, aujourd’hui, oubliée et l’intention du président de la République d’être de nouveau candidat transparaît de plus en plus.
A droite, la primaire prévue à l’automne 2016 semble donner l’avantage, à l’heure actuelle, au président de l’UMP (NDLR devenue Les Républicains depuis) qui maîtrise le parti, dans une stratégie de communication de « rassembleur », et avec le contrôle de ce qui compte vraiment : les fédérations, les investitures et les moyens financiers, aussi modestes soient-ils et aussi élevée soit la dette.
A l’extrême droite, Marine Le Pen engrange les bons résultats électoraux depuis trois ans et se situe à un niveau très élevé dans les sondages d’opinion, ce qui lui permet de viser le second tour de 2017.
Cependant, ce match annoncé et entretenu par les trois personnalités évoquées est loin d’être une certitude. Si François Hollande souhaite tant que Nicolas Sarkozy soit son adversaire en 2017 et si le second espère tant prendre sa revanche sur le premier – chacun utilisant l’épouvantail FN comme le repoussoir justifiant sa propre ambition –, il n’en reste pas moins que cette perspective ne suscite pas l’enthousiasme de l’électorat.
Plus de quatre Français sur dix (41 %) déclarent ne pas vouloir voter pour l’un de ces trois candidats en 2017 (OpinionWay/Marianne, mai 2015). Dans l’histoire des élections présidentielles, c’est un chiffre record à cette distance de l’échéance.
François Hollande, non seulement a déçu une part importante de son électorat et entretenu le doute sur sa capacité à gouverner, mais, en assumant un positionnement « social-démocrate » et en voulant faire évoluer le PS vers la modernité, il a ouvert un espace de contestation interne que Jean-Luc Mélenchon n’a pas réussi à préempter de l’extérieur du PS. Il y a donc un espace politique de ce côté-ci.
Moins d’un électeur sur deux de François Hollande en 2012 est satisfait de son action depuis son élection (48 %) et ils ne sont qu’un sur trois à l’être parmi ses électeurs du second tour (36 %). Dès lors, seuls 44 % des électeurs du président au premier tour de 2012 déclarent qu’ils voteraient pour lui si le premier tour de la présidentielle avait lieu aujourd’hui. Et ils ne trouvent pas d’offre satisfaisante : 45 % des électeurs de François Hollande au premier tour de 2012 disent qu’ils ne pourraient voter pour aucun des trois candidats annoncés et seuls 12 % sont tentés par le vote Mélenchon. (OpinionWay/Le Figaro/LCI, avril 2015)
François Hollande a devant lui le double défi d’obtenir de bons résultats avec sa politique et de rassembler la gauche. La partie n’est pas gagnée d’avance. Sur le plan économique, les signaux sont encore faibles ; sur le plan politique, les faits récents (congrès du PS, divisions chez les Verts) montrent que rien ne lui garantit d’atteindre ce résultat.
A l’UMP, en acceptant finalement la primaire présidentielle, Nicolas Sarkozy a habilement manœuvré pour tenter de s’y imposer. En faisant adopter le changement de nom, le principe du renouvellement des présidents départementaux du parti et la possibilité de nommer lui-même les secrétaires départementaux, il s’assure le contrôle des fédérations, de la machine. Il en va de même pour les investitures législatives, mais le rassemblement – de façade – d’ambitions si contraires au sein de l’UMP empêchera-t-il une mobilisation beaucoup plus large que le « réduit » des adhérents auprès duquel il est dominant ? Les études montrent que plus l’assiette est large, moins il a les faveurs des électeurs.
En cas de primaire, Nicolas Sarkozy domine auprès des sympathisants UMP (60 % contre 29 % à Alain Juppé), mais le résultat est bien plus partagé auprès des sympathisants de droite (48 % contre 39 %) ; il l’est d’autant plus si les sympathisants du MoDem et du centre en général se déplacent puisque, dans ce cas, Alain Juppé est devant (45 % contre 42 %).
Nicolas Sarkozy convaincra-t-il les électeurs qui se sont détournés de lui en 2012 de se déjuger ? À l’automne 2016, les sondages auront une grande importance dans la tête de ceux qui sont susceptibles de participer à la primaire. Ils voudront privilégier celui qui aura des chances réelles de gagner en 2017 et les tentations d’éliminer un ancien président si clivant existeront. Alain Juppé pense qu’avec une participation de 3 millions de citoyens à la primaire il l’emportera. Nicolas Sarkozy pense que ce chiffre ne sera jamais atteint et joue la mobilisation du réduit, du « peuple de droite ». François Fillon, Bruno Le Maire et Xavier Bertand, qui « boxent » aujourd’hui dans une autre catégorie et chacun sur sa propre stratégie, pensent que tout est possible tant le match dans le match peut connaître encore des rebondissements, politiques comme judiciaires.
Enfin, il y a le centre, ou plus exactement les centres, avec une UDI divisée dont les dirigeants ne s’accordent que sur un point : aucun d’entre eux ne peut prétendre, aujourd’hui, remporter l’élection ; et un François Bayrou qui, à défaut de troupes, incarne un espace crédité, aujourd’hui, d’un socle de suffrages indispensable à qui veut accroître ses chances de l’emporter.
François Bayrou est la deuxième personnalité la plus populaire parmi les grands leaders de l’opposition (Baromètre OpinionWay/Metronews/LCI, mai 2015). Il recueille 12 % des intentions de vote si le premier tour de la présidentielle avait lieu demain, en dépit de son choix de se concentrer sur son action locale. (OpinionWay/Le Figaro/LCI, avril 2015)
Le centre, à mes yeux, se trouvent aujourd’hui dans une situation historique. Plutôt que de se demander s’il doit exister par une candidature au premier tour ou peser en se ralliant à celui qu’il pense être le gagnant, dès le premier tour aussi – un schéma qu’il connaît bien dans son histoire –, il peut choisir de peser de manière décisive sur le gagnant du second tour. J’ajoute en guise de provocation, gagnant qui peut être à gauche ou à droite de l’échiquier.
Souvenons-nous surtout que les schémas annoncés deux ans avant l’échéance sont parfois contredits dans notre histoire politique.
On a pu l’observer lors du retrait de Charles de Gaulle – qui a abouti à l’élection anticipée de 1969 – et de la disparition de Georges Pompidou, en 1974, qui ont, bien sûr, bousculé le calendrier électoral, mais plus encore lors de la certitude de la réélection de Valéry Giscard d’Estaing un an avant 1981, de la non-candidature de Jacques Delors en 1995, de l’élimination de Lionel Jospin en 2002 et des événements autour de Dominique Strass Kahn à la dernière échéance présidentielle, etc.
Les intentions de vote mesurées par les enquêtes à deux ans d’un scrutin nous en disent beaucoup sur le rapport de force entre les formations politiques ou les blocs, mais se révèlent souvent plus imprécises sur la dimension particulière, car personnelle, de l’élection présidentielle. Ainsi, Jacques Chirac accusait, à l’automne 1994, près de 15 points de retard sur Edouard Balladur et François Bayrou, à l’été 2006, plafonnait à 7 % des intentions de vote. En 2011, au moment de la primaire socialiste, le candidat PS se situait à plus de 30 % alors qu’aucune trace d’une possible dynamique Mélenchon n’apparaissait (6 % des intentions de vote).
Dans l’axiome gaullien de la rencontre entre un candidat, un peuple et les circonstances, ce dernier élément reste le plus incertain.
Les trois protagonistes du match annoncé tentent, aujourd’hui, d’exclure tout autre schéma que le leur pour s’affronter. Deux d’entre eux comptent sur un plafond de verre qui empêcherait le troisième de gagner et donc s’efforcent de réduire la présidentielle à une élection à un seul tour. Se faisant, ils prennent le risque de prolonger encore un système politique rejeté par une majorité de citoyens. Ils font le pari que c’est à périmètre politique constant que se jouera 2017, le côté très réactif de la société française impliquant selon eux de jouer selon les règles anciennes.
C’est un choix, une stratégie, on verra si les faits leur donnent raison. Pourtant, le paysage politique partisan est dépassé parce que non structuré, même autour des vraies lignes de fracture qui traversent chaque camp en son sein : l’économie libérale responsable, d’une part, et l’Europe, d’autre part. De là vient le refus persistant de former des majorités d’idées au détriment de l’affrontement des blocs.
A quoi servent les partis politiques aujourd’hui ? Ils ne servent que d’écurie présidentielle.
A quoi sert-il d’y adhérer ? Pas à grand-chose. La primaire comme la reconduction automatique du sortant dépossèdent le pouvoir des adhérents qui n’auront bientôt plus leur mot à dire. Les think tanks et conseillers en communication produisent davantage de contenus que les bien faibles secrétariats nationaux internes ; quant aux investitures, nous savons tous qu’elles sont, en général, données dans d’autres circonstances et pour d’autres raisons que celles affichées…
Les trois quarts des Français ont une mauvaise opinion des partis politiques, moins de 2 % y adhèrent, et les trois grands partis sont effectivement déconsidérés : 71 % ont une mauvaise opinion du FN, 72 % de l’UMP et 75 % du PS.
Sortir du « par défaut », c’est envisager un autre visage à la prochaine présidentielle, soit parce que les circonstances en modifieront la donne, soit parce que les Français eux-mêmes manifesteront une envie d’autre chose. Nous avons tous en tête un certain nombre d’idées ou de commentaires entendus de la part de personnes qui veulent un autre chose qui permettrait de redéfinir la notion de « public » (espace, services, etc.) ou même de redéfinir le pacte liant le citoyen à ses représentants. Ce serait alors des considérations de fond plutôt que ces batailles de « mesurettes » auxquelles on assiste durant les périodes de pré-présidentielles.
L’idée d’une « union nationale » apparaît d’ailleurs de plus en plus populaire : 83 % des Français jugent nécessaire que les responsables de camps opposés parviennent à s’entendre pour trouver des solutions aux problèmes du pays.
Le match annoncé donne partout la présence de Marine Le Pen au second tour de la présidentielles comme inévitable.
Les élections municipales, européennes, sénatoriales, départementales ont montré une réelle progression, un enracinement du FN dans la France électorale. L’extrême droite compte bien encore le prouver aux élections programmées avant la présidentielle, les régionales, en décembre prochain.
Au-delà des urnes, de nombreuses études détaillent la montée des rejets dont se nourrit le FN et, parfois même, une forme d’adhésion grandissante.
Une étude réalisée auprès de 500 électeurs du FN souligne qu’ils sont, aujourd’hui, plus nombreux à voter pour ce parti parce qu’il incarne leurs valeurs (58 %) plutôt que pour exprimer leur mécontentement (38 %). Il y a donc, non seulement une progression électorale sur le terrain, mais aussi une évolution quant à l’adhésion et au vote. Et 86 % des électeurs FN souhaitent que Marine Le Pen soit élue présidente de la République, quand moins d’un tiers des électeurs souhaitaient de même pour son père en 2002 (OpinionWay/Le Figaro, 2014). Pour cet électorat, le FN n’est plus là pour jouer, mais pour gagner.
En 2017, grâce aux élus obtenus dans toutes les élections intermédiaires, il est déjà certain que la candidate du FN n’aura plus besoin de rejouer la fameuse course aux 500 signatures obligatoires pour figurer sur la ligne de départ avec ce faux suspense entretenu à chaque élection présidentielle. Est-il pour autant certain qu’elle accède au second tour avec ou sans la possibilité même de l’emporter ? Cela laisse pensif.
A la petite musique de l’UMPS et du « essayez-nous, les autres ont échoué » s’opposent, en effet, la cacophonie de la saga familiale, la critique programmatique, l’image d’un parti qui ressemble de plus en plus aux autres malgré une place dans le jeu républicain qui reste toujours à part.
Si les deux grands partis de gouvernement sont fracturés plus visiblement sur les lignes de fond évoquées précédemment, les autres partis, bien que censés être plus homogènes et moins attrape-tout, se divisent, eux aussi, sur leur ligne stratégique identitaire et existentielle. Cela se voit au centre, tel que déjà évoqué, ainsi qu’au Front de Gauche, chez les Verts, mais aussi au FN, dans cette double confrontation anciens/modernes et France du Nord/France du Sud.
La rupture entre le père et la fille Le Pen, au-delà du vaudeville, révèle ces fractures et incohérences entre un FN canal historique et un « rassemblement Bleu marine » ; entre un fondateur qui se définit lui-même comme un « artiste qui ne quittera la scène que les pieds devant » et une candidate qui « joue pour gagner » et, plus simplement, pour bousculer ; entre une ligne politique dure et une pratique attrape-tout ; entre un parti hors-système et un parti qui en adopte progressivement les règles.
Le « parti caserne » garde le réflexe de suivre le chef, mais, en évoluant et en grandissant, il est gagné par les symptômes connus des partis classiques : querelles d’ambition, affaires, etc.
Aujourd’hui, 53 % des Français perçoivent le FN comme un parti comme les autres (BVA/Orange/Itélé, avril 2015). Là aussi, il s’agit d’une forte progression depuis trois ans.
Depuis les élections départementales, les leaders de la majorité comme de l’opposition, Alain Juppé à droite, Manuel Valls à gauche, d’autres moins audibles aussi, se sont attaqués au FN et à son programme au fur et à mesure que montait la côte de sa présidente ; petit à petit, ce message se diffuse et les prochains dix-huit mois pourraient renforcer cela.
Seuls ses électeurs perçoivent d’ailleurs le FN comme capable de gouverner le pays (93 % contre 33 % des Français seulement) et 52 % des Français estiment que la situation économique empirerait si le FN était au pouvoir (OpinionWay/Metronews/LCI, février 2015).
Nombre d’études ont mis en lumière les similitudes entre ces électorats et, pourtant, les choses évoluent et sont à nuancer. A commencer par la possibilité d’alliance entre l’UMP et le FN. Le FN n’est plus perçu comme l’allié qui fera gagner la droite, mais comme le concurrent qui peut l’éliminer.
Si deux tiers des électeurs du FN souhaitent encore une alliance nationale avec l’UMP, il n’en reste qu’un tiers à l’UMP. Ils ont compris que le FN n’était plus dans une vision romantique de supplétif d’une droite qui avait, seule, vocation à gouverner, mais qu’il était, à présent, dans la position de vouloir tuer la droite existante et prendre le pouvoir. Cette prise de conscience a fait évoluer les choses et je dirais, tant mieux, et donc tant pis pour Marine Le Pen, dans un moment où sa tentative de dédiabolisation et de démarquage de son père aurait pu laisser penser qu’elle allait gagner un peu plus de sympathie dans les rangs d’un électorat plus républicain.
Sur les thématiques de fond, il existe certes des similitudes. Aujourd’hui, sur les enjeux de sécurité et d’immigration, ces deux électorats semblent le plus souvent en phase. Ainsi, 97 % des électeurs FN aux départementales pensent qu’il y a trop d’immigrés en France, tout comme 76 % des électeurs de droite et du centre. De même, 93 % des électeurs FN aux départementales pensent qu’il faudrait supprimer les allocations familiales aux familles des mineurs délinquants, tout comme 77 % des électeurs de droite et du centre (OpinionWay/l’Opinion, mars 2015). Mais la convergence sur ces thématiques n’est guère surprenante dans une société française de plus en plus acquise à ces idées (respectivement 67 % et 73 % (OpinionWay/Observatoire du quinquennat, 2014)). En termes clairs, les points de convergence entre les électorats sont d’autant plus forts qu’ils expriment des opinions partagées par l’ensemble des Français.
Toutefois, dans de nombreux autres domaines, de fortes divergences subsistent, voire se creusent, entre les électeurs de l’extrême droite et de la droite. Certaines tendent même à rendre difficilement compatible l’union entre ces deux courants politiques.
Ces différences de point de vue peuvent être classées en trois grandes catégories.
Dans ce domaine, il semble que nous ayons affaire à deux cultures bien différentes, voire opposées, entre ces deux familles politiques, au regard de leur électorat. L’autoritarisme demeure très prégnant au sein de l’électorat frontiste, bien plus que dans celui de la droite et du centre. Ainsi, quand 89 % des Français, 92 % des électeurs de Nicolas Sarkozy et 95 % des électeurs de François Bayrou, en 2012, jugent qu’avoir un système politique démocratique est une bonne manière de gouverner le pays. Ils ne sont que 79 % parmi les électeurs de Marine Le Pen. De même, 21 % des électeurs de Marine Le Pen estiment que ce serait bien que l’armée dirige le pays, soit près de deux fois plus que ceux qui partagent ce point de vue dans l’ensemble de la population (12 %), dans l’électorat de Nicolas Sarkozy (12 %) ou de François Bayrou (10 %).
La critique à l’égard de la démocratie dans l’électorat FN explique largement ce désenchantement, voire ce détachement, à son égard : 92 % des électeurs de Marine Le Pen pensent que la démocratie ne fonctionne pas bien en France (contre 73 % des Français seulement, 72 % des électeurs de Nicolas Sarkozy et 68 % des électeurs de François Bayrou), 65 % qu’elle ne peut pas maintenir l’ordre (contre 45 % des Français seulement, 52 % des électeurs de Nicolas Sarkozy et 39 % des électeurs de François Bayrou) et 60 % qu’en démocratie le système économique fonctionne mal (contre 47 % des Français seulement, 44 % des électeurs de Nicolas Sarkozy et 43 % des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, signe que cet indicateur dépasse la simple mesure du mécontentement social).
Face au sentiment grandissant que les hommes politiques n’ont plus d’influence sur le cours des choses en France (57 % des électeurs FN aux départementales sont de cet avis, contre seulement 43 % des électeurs de la droite et du centre), il existe clairement dans l’électorat FN un rapport particulièrement conflictuel avec le principe même de la démocratie représentative : 82 % considèrent que, lorsque le gouvernement n’est pas d’accord avec ce que la plupart des gens pensent, il doit changer ses projets politiques et 75 % que ce devraient être les citoyens, et non un gouvernement, qui décident ce qui est meilleur pour le pays. (Baromètre Cevipof/OpinionWay de la confiance politique, février 2015)
Clairement, l’électorat FN est aujourd’hui beaucoup plus dirigiste que celui de la droite et du centre. Même s’il privilégie la valeur liberté (57 %), il le fait sensiblement moins que celui de la droite et du centre (63 %). Surtout, alors que dans le pays les indicateurs d’opinion soulignent que de plus en plus de Français souhaitent, pour faire face à la crise économique, que l’on donne plus de liberté aux entreprises (+ 24 points depuis décembre 2011), ce phénomène touche moins l’électorat FN : quand 84 % des électeurs de droite et du centre pensent ainsi, seuls 63 % des électeurs FN y sont favorables. Cette tendance à être plus réfractaire à plus de liberté économique est confirmée par d’autres indicateurs (OpinionWay/l’Opinion, mars 2015) :
seuls 53 % des électeurs FN aux départementales sont favorables à la suppression complète des 35 heures (68 % à droite et au centre) ;
seuls 38 % des électeurs de Marine Le Pen en 2012 pensent que le mot privatisation est positif (contre 60 % des électeurs de Nicolas Sarkozy et 55 % des électeurs de François Bayrou) ;
46 % des électeurs de Marine Le Pen en 2012 pensent que, pour établir la justice sociale, il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres (contre 20 % des électeurs de Nicolas Sarkozy).
Dès lors, il n’est guère surprenant que seuls 48 % des électeurs de Marine Le Pen pensent que le mot libéralisme est positif, contre 77 % des électeurs de Nicolas Sarkozy et 63 % des électeurs de François Bayrou. Cette divergence économique tend à se renforcer depuis la dernière élection présidentielle dans la mesure où l’électorat de droite et du centre redevient sensible aux propositions économiques libérales, ce que l’on ne constate pas au FN, tout du moins dans les mêmes proportions. (OpinionWay/Observatoire du quinquennat, 2014)
C’est probablement sur cette dimension que la fracture est la plus flagrante. En effet, 76 % des électeurs FN aux départementales déclarent que la France doit se protéger davantage du monde plutôt que de s’ouvrir, contre 31 % seulement à droite et au centre. La réticence des électeurs à l’égard de l’Europe est avant tout une inquiétude à l’égard de l’extérieur du pays. Mais elle se traduit, sur le rapport à l’Europe, par des attitudes totalement opposées, aussi bien sur la perception présente que future. Ainsi, 53 % des électeurs FN aux départementales déclarent que l’appartenance de la France à l’Union européenne est une mauvaise chose, mais 63 % des électeurs de la droite et du centre pensent que c’est une bonne chose. Et alors que 46 % des électeurs FN sont favorables à la disparition de l’euro et au retour au franc, 80 % des électeurs de la droite et du centre y sont opposés. (OpinionWay/l’Opinion, mars 2015)
Le rapport à la démocratie explique cette place à part du FN dans le jeu républicain. L’économie et l’Europe renvoient, elles, aux lignes de fracture au sein des partis politiques exposées précédemment, mais ils sont surtout tous les trois autant d’axes pour 2017 de pédagogie et de vérité politiques.
Ces éléments, que nous avons rassemblés, permettent de montrer que l’environnement évolue. Pour certains, mon propos sera du wishful thinking (prendre ses désirs pour des réalités), pour d’autres de la provocation. Je réponds qu’il ne s’agit ni de l’un ni de l’autre. La situation bouge par rapport à ce que l’on vous dit être la donne de 2017, le match annoncé, et la présence incontournable de Marine Le Pen au deuxième tour. L’année 2015 est une course de sur-place des acteurs politiques, c’est d’ailleurs le regret de nombre de Français qui ont l’impression que les politiques ne s’occupent pas d’eux. Il peut se passer beaucoup de choses en dix-huit mois compte tenu du rapport de plus en plus négatif des Français à la politique et aux hommes et aux femmes politiques.
Édouard Philippe. – J’ai été très intéressé par les données fournies par Xavier Chinaud. Sur le trio François Hollande/Nicolas Sarkozy/Marine Le Pen, personne ne sera surpris si j’affirme que les choses ne se passeront pas forcément telles qu’on les imagine.
Dans un système politique comme celui de la Ve République, il y a des constantes, qui prédominent assez largement, et des transformations, qui sont plus rares. Lorsque j’étais étudiant, nous apprenions la « grammaire de la Ve République », grammaire assez structurante avec son scrutin uninominal majoritaire à deux tours qui séparait la vie politique en deux camps, qui eux-mêmes se subdivisaient encore en deux camps : la droite et le centre qui représentaient la droite, et le parti socialiste et le parti communiste qui représentaient la gauche. Le premier tour de l’élection présidentielle permettait de choisir celui qui allait se présenter au second et le second rassemblait les blocs. Cette grammaire de la Ve République faisait que ce système fonctionnait, certes, avec plusieurs partis, mais seulement avec deux camps. Tout cela a profondément changé, non pas à cause d’une révision constitutionnelle soudaine, mais parce que nous sommes entrés pour des raisons politiques diverses dans un système à trois camps. Nous sommes entrés officiellement dans cette phase en 2002 lorsque Lionel Jospin fut défait au premier tour et, depuis, cela a continué ainsi. Nous sommes aujourd’hui avec un suffrage uninominal majoritaire à deux tours dans lequel trois camps peuvent prétendre se qualifier pour le second tour. La donne est modifiée radicalement, tout comme la stratégie politique, les résultats électoraux et la fonction des partis.
Tout cela va très loin car nous sommes presque capables aujourd’hui de savoir, avant l’élection, quels en seront les résultats. Désormais, si un des camps se présente divisé à l’élection, il est certain de perdre ; mais s’il se présente uni, il n’est pas sûr de gagner. Aux départementales, qui se font aussi sur un scrutin uninominal majoritaire à deux tours, la division au premier tour entre les socialistes, les écolos, les communistes, a eu un impact mécanique : l’élimination de la gauche au premier tour dans différents endroits où elle aurait pu être présente au second tour dans l’ancien monde, voire où elle aurait même pu gagner. Les résultats sont donc très largement transformés par ce système d’élimination au premier tour.
Le rôle des partis politiques est lui aussi transformé. La réponse du parti socialiste en 2007 et en 2012 et de la droite pour 2017 à cette nouvelle grammaire, c’est la primaire. Auparavant, le premier tour permettait de faire un choix dans chaque camp, ce n’est désormais plus possible. Il faut choisir avant le premier tour et organiser une primaire, fermée ou ouverte – chacun peut avoir son opinion – mais qui, en tout état de cause, doit légitimer le candidat et écarter ceux qui auraient vocation ou envie de se présenter. Cela a été vrai pour la gauche lorsqu’elle était dans l’opposition et ce sera vrai pour la droite aujourd’hui dans l’opposition. À mon avis, aussi longtemps que l’on restera dans une grammaire à trois, le parti principal de l’opposition fonctionnera avec des primaires pour choisir son candidat. Cela n’est pas un effet de mode, ni une vertu, il s’agit simplement de la conséquence de cette transformation. Elle modifie ainsi le rôle des partis, qui était précédemment de soutenir un chef, de proposer des idées. C’est désormais un système d’organisation de primaires qui prévaudra dans les partis et la production de contenus sera quoi qu’il arrive moindre. La nature du parti s’en trouve réellement affectée. Mes collègues socialistes me disent qu’ils ont sous-estimé l’impact des primaires sur notre fonctionnement interne. Je pense que cela sera la même chose à l’UMP.
Jérôme Guedj – Il y a vingt-trois ans, nous préparions l’ENA avec Édouard Philippe. Il était un peu « rocardien », j’étais assistant parlementaire de Jean-Luc Mélenchon dont nous occupions le bureau pour réviser. Globalement, tous les deux, nous n’avons pas bougé sur le fond. À l’époque, j’étais un affreux gauchiste de l’aile gauche du parti socialiste ; aujourd’hui, je suis un frondeur. Cela signifie globalement un social-démocrate qui essaie de s’en tenir à une matrice qui était à peu près celle de Lionel Jospin au début des années 2000. Je caricature, mais, de la même manière, je suis convaincu qu’une grande partie de la matrice de Édouard Philippe était déjà présente à ce moment-là.
En revanche, le fait majeur de cette nouvelle donne, c’est le glissement et le durcissement de la société et, par conséquent, de son offre politique.
Nous n’avons pas bougé, mais le centre de gravité s’est déplacé à droite. On aboutit à ce que d’autres appellent un « grand dérèglement » de l’offre politique dont la responsabilité appartient aux responsables politiques. Quand la gauche singe la droite, que la droite court après l’extrême droite et, quand cette dernière met sur la table des éléments d’inspiration de gauche, on se trouve les uns et les autres forts désemparés.
Ce concept comporte une certaine incertitude que l’on a rarement vue dans le champ politique. A l’approche de l’échéance de 2017, nous ne pouvons pas jouer avec le feu, ni avec les allumettes. C’est un peu la théorie du chaos appliquée en politique. Le battement d’ailes à un endroit du monde peut provoquer un cyclone à un autre endroit bien plus lointain. Le système autorégulé est perturbé. La roue à eau tourne dans un sens, mais une seule goutte d’eau peut l’entraîner dans l’autre sens. On a récemment vu qu’un battement d’ailes au Sofitel de New York a pu dérégler le système. Dans ce « ménage à trois », le pari consiste à dire « je suis prêt à prendre le risque, je reste à périmètre constant ancien, personne n’a envie d’en sortir et j’assume les conséquences qu’il comporte ». C’est assez vertigineux comme raisonnement ; mais parfois, la somme des désaccords à gauche ou une vieille inimité personnelle peuvent aider à la candidature ou la ruiner.
Un sentiment commode d’irrationalité apparaît. Ce dernier terme est pratique et a beaucoup été utilisé au moment des départementales pour mettre un mot sur l’attitude des communistes. Lorsque j’ai déjeuné il y a quelques jours à l’Élysée avec tous les présidents de départements qui ont perdu leur département mais pas leur canton, nous avons fait une sorte de thérapie de groupe. Tous, comme moi, essayaient de comprendre comment et pourquoi nous étions arrivés à cette situation de division avec notre partenaire historique avec lequel nous avions géré dans le passé toutes nos collectivités. Nous avions de nombreux vice-présidents communistes, loyaux, fidèles. Dans quasiment tous les cantons de France, alors que la menace de l’élimination était connue, palpable, mesurable depuis les élections européennes, le choix fut, pourtant, suicidaire et irrationnel : la division. Ce sont ces deux mots qui sont le plus revenus au cours de ce déjeuner. Et pourtant, de leur point de vue, en tout cas de celui des militants, il y avait une sorte de rationalité dans cette décision. Un hiatus existe entre les états-majors communistes qui souhaitaient plutôt la reconduction des accords et la base militante qui poussait pour l’autonomisation. La gauche doit donc assumer sa défaite. Ce détour m’a permis d’expliquer l’irrationalité qui peut se produire à l’approche de la présidentielle. Pourtant, il existe tout de même quelques points assez structurants.
J’ai ainsi un désaccord quant au fait que Marine Le Pen soit résistible dans le moment. Je n’y crois pas et je pense qu’il faut que tout le monde intègre que le Front national est dans une réelle dynamique électorale. C’est ce qui est le plus frappant pour ceux qui viennent de vivre les élections locales. La dynamique des thématiques et des sujets qui sont ceux des Français aujourd’hui donnent du crédit au Front national.
Vous avez tous observé le succès des mouvements comme Podemos aux récentes élections espagnoles. La gauche se demande du coup : est-ce que cela pourrait arriver en France ? Dans quelles conditions ? Eh bien, cela ne serait pas possible actuellement dans notre pays. Ces mouvements ont la particularité d’agréger des luttes (contre l’évasion fiscale, l’expulsion, l’exploitation de la nature, etc.). Ce qui les a coagulés, c’est le discours caricaturé de l’antisystème, anti-élites, anti-élus, anti-politique à l’ancienne d’une certaine manière. Or, cet espace-là, pour l’instant est préempté et occupé par le Front national. Personne à gauche, aujourd’hui, ne peut arriver avec ce même type de discours.
J’ai été frappé pendant l’élection départementale par l’ampleur du rejet de ceux qui sont engagés dans l’action publique et la démonétisation de leur message. Nous avons tous une responsabilité dans cela.
La centralité du Front national et des thématiques qu’il porte est aussi, d’une certaine manière, marquée par le rapport à la République et, à l’intérieur de cela, par le rapport à la fraternité. J’ai senti, lors de ces élections locales qui ont eu lieu après le 11 janvier, une dureté par rapport à certaines populations. La question de l’identité du pays est entrée dans le débat et, malheureusement, légitime le débat engagé par le Front national.
Au sortir de l’élection présidentielle de 2017, il y aura une crise majeure. Le parti politique défait à cette élection le sera par le Front national et, par conséquence, implosera. C’est ce qui justifie une partie du travail que je mène au sein du parti socialiste. Mais il faut peser maintenant. A rebours de la rationalité suicidaire des « mélechonistes » selon laquelle après la nécessaire disparition du PS il faudra que, sur la terre brûlée, fleurissent mille Podemos, Syriza, au prix de cinq ans de victoire de la droite ou de l’extrême droite. Le « par défaut » est stimulant car j’en ressors une grande motivation des électeurs, notamment dès le premier tour. La dimension d’adhésion et d’enthousiasme à une élection existe parfois même dans un rejet. Ce fut le cas d’une partie du vote des quartiers populaires pour mettre dehors Nicolas Sarkozy. La dimension de désenchantement, pour faire échos au discours du Bourget et à la notion de ré-enchantement, est une promesse non aboutie.
La nouvelle donne se nouera dans le vote du 7 mai 2017. Cette nouvelle donne politique, issue de la matrice présidentielle dont dépend la politique française, va entraîner une recomposition à droite, à gauche, voire dans les deux camps.
Xavier Chinaud. – Loin de moi l’idée de sous-estimer le Front national. Cela fait vingt-cinq ans que je les suis. J’ai écrit, bien avant que l’actuel ou l’ancien Premier ministre ne s’en inquiètent, que le plafond de verre n’existait plus et que, contrairement à ce que l’on croit, Marine Le Pen était potentiellement éligible à la présidence de la République. Ce que je conteste, c’est le match annoncé par tous les médias. Mon étude est une incitation aux candidats modérés, de droite comme de gauche, à mieux réfléchir à la situation. Il existe des points de divergence entre les électorats et les acteurs politiques qui nécessitent qu’ils fassent réellement un travail de pédagogie.
Vous pensez, Jérôme Guedj, que l’on va jouer à périmètre constant en 2017 et que cela n’explosera qu’après. Une majorité de Français aimerait pourtant avoir une offre politique qui permette que cela éclate avant. Le débat est là. Ma modeste expérience me pousse à ne plus croire au grand soir et à la révolution depuis pas mal d’années et j’ai peur que vous ayez, cependant, raison.
Enfin, un dernier point sur Podemos et l’Espagne. J’observe deux facteurs très impressionnants. D’abord, remarquer que la classe politique espagnole est bien plus corrompue que la nôtre. Cela a atteint de tels sommets que cela a été un vrai catalyseur en Espagne. L’autre élément important à prendre en compte est la rencontre politique entre le mouvement des indignés et des populations qui ont supporté des mesures économiques dont le début du commencement n’est même pas envisagé par les Français. Je ne suis donc pas certain de la transposition du cas espagnol à la France.
Michel Piron, député du Maine-et-Loire. – Vous avez parlé de la crise de la représentation. Ne pensez-vous pas qu’il y ait aussi une crise de la présentation et, dans ce domaine, je pense aux médias ? Quel rôle les médias jouent-ils sur la possibilité même de faire ou de ne pas faire de la politique ?
Jérôme Guedj. – Bien sûr, il y a une course un peu frénétique et une saturation de l’« anecdotisation » de la vie politique. C’est malheureux à dire, mais à un moment donné, pour nous, frondeurs, les médias furent le seul espace d’expression. Le débat nous était interdit dans notre formation politique. Nous vivions avec une chape de plomb qui, usant de la Ve République et du fait présidentiel, rendait impossible la tenue de discussions. Je ne veux donc pas déresponsabiliser les politiques en disant que c’est la faute des médias et de cette fâcheuse tendance à ne retenir que la petite phrase. L’intensification frôle parfois l’insupportable, mais c’est au diapason de la faiblesse ou, du moins, de l’évitement des débats de fond par les politiques.
Je ne veux pas donner l’impression de ne pas répondre à la question du grand dérèglement, mais je jette une petite pierre dans le jardin des centristes. Quand la gauche s’assume, est décomplexée par rapport à ses idées, et que la droite ne se cherche pas non plus, j’ai l’impression que le débat politique est plus serein et peut-être qu’à ce moment-là l’espace du centrisme se réduit.
Edouard Philippe. – Concernant les médias, on peut aimer ou non, s’en servir ou non, je considère que cela fait partie des données. Quand je lâche une pomme, elle tombe ; quand je ne dors pas, je suis fatigué. C’est pareil avec les médias. Ils sont là et c’est comme ça. Ils vivent à leur propre rythme, se transforment progressivement avec, par exemple, l’information en continue. Ils offrent des espaces bien plus importants à ceux qui se trouvent dans une situation critique. Les minoritaires et les extrémistes ont un accès aux médias bien supérieur à leur poids politique réel. On le sait tous. Si vous avez une position défendue par un groupe de cent députés, avec quatre-vingt-cinq députés pour et quinze contre, je vous garantis que les quinze contre auront le même temps d’audience que les autres, voire plus. C’est donc une donnée. La responsabilité essentielle ne me semble pas être celle des médias. Elle relève des élus, des politiques, des analystes qui nourrissent – ou non – le débat. Je pense que nous avons une responsabilité collective qu’il ne faut pas renvoyer aux médias.
Sur la recomposition du monde politique, je vais vous raconter une anecdote. En 2003, un centriste éminent, Valéry Giscard d’Estaing, vient aux premières universités d’été de l’UMP. J’ai la charge de l’accueillir en tant que directeur général du parti. Il me demande de lui expliquer le fonctionnement de l’UMP. J’essaie d’être clair et précis. Il me dit que c’est très intéressant, mais que cela ne marchera pas pour une raison simple : « En créant l’UMP, me dit-il, vous voulez structurer la vie politique autour de deux camps, la gauche et la droite. Or, ce ne sont jamais les partis politiques qui font cette structuration, mais le mode de scrutin. Comme vous ne l’avez pas changé, il va continuer à vous structurer. Et donc vous ne pourrez pas “dégommer” le centre ». Ce qui n’était pas dans notre intention de toute façon. Il avait raison.
Je suis, pour ma part, un partisan du suffrage uninominal majoritaire à deux tours et je ne suis pas favorable à la proportionnelle. Aussi longtemps que nous le maintenons, il demeurera un ensemble qui existe intellectuellement et politiquement, même s’il ne se voit pas à l’Assemblée nationale, et qui va des libéraux-modérés aux socio-démocrates-libéraux. On voit bien qu’un des éléments de continuité dans notre pays qui subit l’alternance, c’est justement ce bloc intellectuel, non pas centriste, mais central. C’est le cœur de l’omelette et je ne suis pas sûr qu’il arrive à se dégager ni à s’incarner dans une force politique spécifique. Je suis même persuadé du contraire à mode de suffrage constant et en l’absence de crise grave. Les deux seuls éléments de réorganisation possibles seraient soit la réorganisation du mode de suffrage – et je ne suis pas sûr qu’on puisse l’imaginer –, soit un élément exogène dur – une crise violente. Faut-il s’en plaindre ? Je n’en suis pas certain.
L’autre donnée extraordinaire du système politique français est, à la fois, qu’il produit une très grande stabilité des institutions pendant le mandat législatif et qu’il n’a, depuis 1978, jamais réussi à créer une forme de continuité entre les majorités. Blair a fait trois mandats, Schröder trois également, Cameron deux. Où est la majorité sortante qui a réalisé un second mandat en France depuis 1978 ? Il n’y en a pas. Nous n’avons pas le temps. Les gouvernements ratent soit parce qu’ils ont de mauvaises idées, soit parce qu’ils en ont de bonnes, mais manquent de temps pour enraciner leur action dans la continuité et donc dans l’efficacité. Nous n’avons pas créé un système politique qui permette d’avoir des majorités stables dans le temps, dans le mandat oui, mais pas au-delà. Seule reste cette omelette intellectuelle centrale qui permet la continuité et, éventuellement, s’enracine dans la vie politique.
Je ne suis ainsi pas sûr qu’il faille une totale recomposition, ni qu’on s’y dirige.
Jérôme Guedj. – Je ne souhaite pas, pour ma part, garder le scrutin majoritaire uninominal. Les partis politiques sont sclérosés du fait de la généralisation des primaires. Ils ne sont plus que des machines à fabriquer des candidats, comme c’est déjà le cas depuis un moment, avec des logiques d’investiture. Le travail de fond est atténué, même s’il a existé à certaines périodes. Très sincèrement, de 2009 à 2011, le parti socialiste a travaillé. Cela n’a pas servi à grand-chose, le candidat faisant ce qu’il voulait. Aujourd’hui, et avec les primaires, je confirme que le PS a changé de nature. J’étais au départ un adversaire de la primaire, au moment où l’idée est lancée par Martine Aubry, en 2009, pour ressouder le parti après la défaite aux élections européennes. Nous étions plusieurs à dire que cela allait entraîner une dépolitisation accrue en se soumettant à la démocratie « sondagière » et aux principes médiatiques. Nous pensions que cela dénaturerait cette idée d’avant-garde éclairée que constitue l’engagement dans un parti politique. Si les partis ne sont plus réduits qu’à cette fonction d’organisateur de primaires et de délivreur d’investitures, rien ne bougera, alors même que pour la composition de majorité d’idées, les partis sont nécessaires.
Il faut donc de la proportionnelle, pas aussi forte qu’en Israël, mais on sait bien qu’il est possible d’avoir un système proportionnel compatible avec une stabilité politique. Le scrutin proportionnel est un préalable à la recomposition politique et n’est pas à exclure aujourd’hui pour différentes raisons. Le prisme mitterrandien de François Hollande est présent, alors que l’on se rapproche d’élections difficiles et que certaines composantes de la majorité réclament ce mode de scrutin. Aujourd’hui, il n’y a plus le temps matériel d’organiser un système de proportionnelle partielle avec le redécoupage qui avait été envisagé. La rationalité politique conduirait donc à laisser ouverte la porte de la proportionnelle intégrale et je suis étonné qu’elle soit fermée par le président lui-même. Mais je ne serais pas surpris, sur ce terrain comme sur d’autres, qu’un revirement arrive car c’est un des préalables à l’union de la gauche ou du moins à celui des candidatures de 2017.
Yves Pozzo di Borgo. – Je voudrais remercier les intervenants et la clarté de leurs propos. Les débats nous divisent, mais l’amitié et le respect souvent l’emportent. Nous sentons derrière ces débats, qui durent depuis plusieurs années, une sorte d’unité sur la nécessité pour le pays d’aborder les problèmes plus profondément. Lorsque l’on regarde ce qui se passe dans d’autres pays, comme l’Espagne, on observe une volonté du citoyen de revenir dans le débat public. Tant mieux. C’est vrai que, souvent, le débat politique n’est pas la première préoccupation du citoyen qui souffre du fait de la crise. Notre débat est donc sain et positif pour la santé politique de la France.