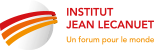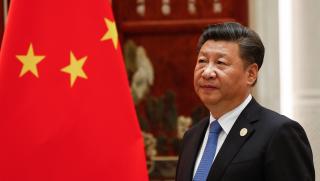« Il est impératif de repenser le système de santé mondial »
Articles de la revue France Forum
Quand les États critiquent l’OMS, ils se critiquent eux-mêmes.
France Forum. – Les États, dans leur ensemble, auraient-ils pu mieux anticiper la crise de la Covid-19 ? Ce type d’événement sanitaire fait-il partie de l’imprévisible ?
Philippe Douste-Blazy. – Malgré les considérables progrès effectués par les hommes depuis deux siècles dans le domaine de la santé, il est évident que d’imprévisibles épidémies, voire pandémies, sont toujours possibles. C’est la raison pour laquelle, nous avions présenté avec mon équipe1, en 2004, le premier plan de lutte contre une pandémie virale. Ce plan a été proposé à l’Assemblée nationale et lors d’une conférence de presse dans une indifférence totale. Il prévoyait le contrôle des frontières, éventuellement leur fermeture, la réquisition de l’industrie textile pour la fabrication de masques, la mise en place de tests diagnostiques et la constitution d’éventuels traitements. Le plan proposé à la fin du mois d’avril par le Premier ministre, Édouard Philippe2, en reprenait l’essentiel. Deux ans plus tard, en 2006, le président américain, George W. Bush, présentait un plan de pandémie pour les États-Unis, suivi de Bill Gates, en 2015.
La conclusion, c’est que, malheureusement, la médecine est considérée par la plupart des chefs d’État et de gouvernement comme étant uniquement une médecine curative et individuelle : « Je suis malade, je vais chez le médecin. » C’est un rapport de confiance de la part du malade et un rapport de conscience de la part du médecin. La médecine préventive et communautaire est, elle, très rarement prise en compte. Or, c’est ce qu’on appelle la santé publique. Cet aspect, ignoré pendant tant d’années, a abouti à l’impréparation de la plupart des États devant l’épidémie que l’on connaît aujourd’hui. En effet, face à une épidémie, quatre questions se posent : Connaît-on le microbe ? Existe-t-il un test pour le dépister ? Est-il virulent et contagieux ? Existe-t-il un traitement ?
Il est évident que les pays qui ont une la culture d’une médecine préventive et communautaire, autrement dit les pays qui ont une culture de santé publique, ont eu un taux de mortalité quatre à cinq fois moins important que ceux qui n’avaient pas développé de politique de santé publique. La stratégie devant une maladie infectieuse est simple : il faut tester. Lorsqu’une personne est testée positive et est porteuse du microbe, il faut l’isoler si l’agent infectieux est contagieux et, ensuite, il faut la traiter si l’on dispose d’un traitement. En même temps, quand l’agent infectieux est contagieux, il est impératif d’identifier les personnes qui ont été en contact avec le malade. Ce que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle « test, isolate and trace ».
Dans des pays comme la Corée du Sud, l’Islande, l’Allemagne ou l’Autriche, la stratégie sanitaire de dépistage massif, d’isolement des malades, de traçage des cas contacts et d’hospitalisation des patients a permis de diminuer considérablement le taux de mortalité. À l’inverse, les pays pris au dépourvu, comme la France, ont eu un taux de létalité très élevé. Des conséquences doivent en être tirées et la santé publique, la médecine préventive et communautaire, doivent devenir un des pans essentiels des systèmes de santé.
Comment une administration, celle de la santé et des affaires sociales, est-elle capable de mettre en place, la première dans le monde, un plan de pandémie virale et, plus de quinze ans après, l’avoir totalement ignoré ? C’est une question que l’administration et le système politique français doivent se poser.
FF. – L’Organisation mondiale de la santé est la cible de critiques de la part de certains États, notamment des États-Unis. Ces critiques sont-elles fondées ou l’OMS est-elle un bouc émissaire facile ?
PDB. – Il faut que les États comprennent – et donc leurs peuples – que, chaque fois, qu’ils critiquent les Nations unies, ils se critiquent eux-mêmes. En effet, les Nations unies ne sont que la résultante des décisions des chefs d’État et de gouvernement. L’OMS a montré à quel point elle était dépassée par cette crise, non parce que son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, n’était pas à la hauteur, mais parce que les États ne se sont pas dotés d’une organisation efficace et capable de mettre en place dans tous les pays un système de santé primaire de qualité permettant de lutter efficacement contre une pandémie. Certes, le directeur général a fait l’erreur de ne pas reconnaître l’épidémie au début, mais ce n’est pas cela qui explique les carences de l’OMS.
En 2005, après l’épidémie de Sars, déjà un coronavirus virulent, les États avaient souhaité doté l’OMS d’un règlement sanitaire international (RSI). Ce règlement devait faire en sorte que tous les pays du monde soient dotés d’un système de santé minimum pour permettre aux pays de lutter contre les épidémies. Le problème est que les chefs d’État et de gouvernement n’ont pas voulu que l’OMS puisse être dotée de méthodes contraignantes. Autrement dit, ce que les États ont organisé pour le commerce international en dotant l’Organisation mondiale du commerce de moyens contraignants, ils n’ont pas voulu le faire pour l’OMS. Aujourd’hui, les pays paient, non pas les insuffisances d’un directeur général, mais celles d’une OMS qui a un budget de 2 milliards de dollars par an pour cent quatre-vingt-dix pays ! Cela est-il normal ? Et que dire des quatre-vingts pays qui n’ont même pas de système de santé primaire ?
Il est nécessaire que, demain, l’OMS soit dotée de moyens contraignants. L’ancienne directrice générale de l’OMS, Go Harlem Brundtland3, avait évoqué une couverture santé universelle. On en est bien loin. C’est d’autant plus grave qu’avec les moyens de communication actuels (4 milliards de voyageurs par an par avion), les épidémies ne s’arrêtent plus aux océans. Plus un maillon sera faible, plus le risque d’épidémie sera accru. Ne pas le comprendre est une faute politique majeure.
FF. – Comment réinventer la gouvernance multilatérale de la santé ?
PDB. – Il existe aujourd’hui une OMS qui en a le nom, mais pas les compétences. On n’organise pas la santé publique dans le monde avec 2 milliards de dollars par an. Par ailleurs, certaines contingences politiques sont beaucoup trop présentes au sein de l’OMS. Si de grands discours sont régulièrement faits, la santé est considérée comme un bien public mondial et non comme un bien public universel, ce qu’elle devrait être. Chaque être humain devrait avoir droit à une bonne santé. L’eau potable et la nourriture devraient être des biens publics universels au même titre que l’éducation et l’assainissement. C’est à ce titre-là qu’une santé mondiale universelle serait possible. Cela passe aussi par des budgets importants. Il faut savoir aussi que la fondation de Melinda et Bill Gates représente 25 % du budget de l’OMS. Cela signifie que tous les pays du monde ne donnent que 75 % de 2 milliards de dollars par an !
Depuis le début des années 2000, grâce à la volonté politique de certains chefs d’État – Jacques Chirac, George W. Bush et Tony Blair, pour ne pas les citer –, ont été créés des fonds verticaux, c’est-à-dire des fonds directement dédiés à certaines maladies. C’est comme ça qu’ont été créés le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le fonds mondial pour les vaccins (Gavi), Stop TB contre la tuberculose et Unitaid. Ces fonds, dotés, pour la première fois de l’histoire, de milliards de dollars, ont permis de diminuer de moitié la mortalité infantile et maternelle dans le monde. C’est extrêmement efficace. Les chefs d’État n’ont pas voulu que ces fonds passent par l’OMS, jugée trop bureaucratique. Ce qui prouve bien un dysfonctionnement.
Maintenant que ces fonds verticaux fonctionnent, on devrait en prélever une partie pour consolider les systèmes de santé primaire des pays. Faire parvenir des médicaments extrêmement coûteux contre le cancer dans des pays pauvres est une très bonne chose, mais si la première cause de mortalité des enfants est la diarrhée, ce sont des travaux d’assainissement qui permettraient de diminuer le taux de mortalité de manière importante et certainement beaucoup plus qu’en faisant venir des médicaments.
FF. – À l’image de ce qu’a fait Unitaid avec la taxe sur les billets d’avion, faut-il mettre en place une nouvelle taxe qui permette à certains pays d’accéder à des traitements trop onéreux ?
PDB. – En réalité, il est impératif de repenser le système de santé mondial. On peut comprendre qu’il existe un marché de la santé dans les pays dotés d’assurance maladie. Dans les pays où l’extrême pauvreté sévit largement, il est difficile d’accepter que des médicaments existent et ne soient pas à la disposition des plus pauvres. Qu’un médicament existe au Nord et qu’il ne puisse pas être donné à un malade du Sud, c’est un véritable crime. C’est pourquoi la première communauté de brevets de médicaments a été créée, en 2009. Jusque-là, lorsqu’un médicament nouveau et très efficace était découvert, il était vendu très cher dans les pays du Nord et il fallait attendre dix ou quinze ans, c’est-à-dire la période où la propriété intellectuelle tombait, pour que les populations des pays pauvres puissent y avoir accès. Ainsi, a été créé le Medecines Patent Pool pour la tuberculose, les hépatites et le sida. Depuis, lorsqu’un médicament est mis sur le marché, il est disponible en même temps à Londres, New York, Paris, Bamako ou Addis Abeba. C’est certainement ce dont je suis le plus fier de toute ma vie politique ! Cela a été un long combat, mais il a été gagné. Barack Obama et Joe Biden ont soutenu ce projet dès le début. Avec les laboratoires pharmaceutiques ont été trouvés les voies et les moyens juridiques pour que cela fonctionne. Dans la mesure où ce qui vaut 100 au Nord ne vaut plus que 2 ou 3 au Sud, trouver de nouvelles sources de financement est moins crucial. C’est un nouveau capitalisme du médicament qu’il faut continuer à inventer.
FF. – Quelle volonté manque pour le faire ?
PDB. – Les générations futures ne comprendront certainement pas qu’il y a pu y avoir des centaines de millions de morts alors que les médicaments pour soigner les malades existaient. Cet égoïsme fera partie de l’histoire au même titre que l’esclavage. On a refusé de soigner des gens alors que les traitements existaient. C’est une question extrêmement importante qui, malheureusement, ne fait l’objet d’aucune ligne dans les programmes politiques.
Il serait malhonnête de mettre la faute sur les laboratoires pharmaceutiques. Ce sont des entreprises qui ont un modèle économique. Ce qui est scandaleux, c’est que les dirigeants politiques n’aient pas changé le système.
FF. – Le modèle économique de la recherche conduit-il à l’élimination d’office des anciennes molécules ?
PDB. – Le système est purement capitaliste. Un laboratoire n’a pas intérêt à développer le marketing d’un médicament peu rentable, mais plutôt à développer la valeur ajoutée d’un médicament dernière génération. Repositionner d’anciennes molécules est certainement une clé pour demain pour la recherche médicale, mais pas pour les laboratoires pharmaceutiques. Il est pourtant impératif de repositionner des molécules anciennes et d’arrêter cette course en avant, même s’il est très important de mettre au point de nouveaux médicaments qui apportent des qualités nouvelles.
FF. – La dépendance française et européenne dans le domaine pharmaceutique doit-elle être repensée ?
PDB. – La crise sanitaire actuelle a montré la dépendance européenne à deux pays : la Chine et l’inde qui produisent plus de 70 % des principes actifs nécessaires à la fabrication des médicaments.
En cas de conflit aigu avec ces pays, l’europe ne serait plus en capacité de produire des médicaments aussi simples que le paracétamol.
Ceci est extrêmement grave et montre qu’au cours des trente dernières années, où il était courant de parler de mondialisation heureuse, le seul marché était l’alpha et l’omega de notre politique économique. Cela a abouti, d’un côté, à une diminution des prix (un médicament produit en inde ou en Chine n’a pas le même coût de production qu’un médicament produit en Europe) et, de l’autre, à une perte de souveraineté dans des domaines stratégiques comme la santé. De la même manière, il faudrait rétablir une souveraineté dans le domaine de la défense qui repose sur deux piliers : l’Otan et l’Europe de la défense. Or, la diminution du budget de la défense des États membres est une catastrophe et, en cas de conflit, il serait illusoire de compter sur les États-Unis. Il est impératif de retrouver une souveraineté numérique également. La dépendance des réseaux numériques à la Russie, la dépendance des aéroports européens à la Chine et la dépendance des GPS ou des messageries électroniques aux États-Unis ne sont pas acceptables.
Cela forme un tout avec la dépendance sanitaire et l’objectif d’indépendanc qui doit être retrouvée au niveau européen. Des unités de production de médicaments princeps doivent être relocalisées, même au prix de médicaments plus coûteux.
FF. – Cette indépendance peut-elle être retrouvée en implantant des industries, notamment pharmaceutiques, en Afrique ?
PDB. – En réalité, la souveraineté doit être d’abord européenne. Produire des médicaments avec des microgrammes de principe actif est d’une complexité absolue. Cela nécessite une formation qui n’est pas possible, aujourd’hui, en Afrique. Elle le sera bientôt.
À l’inverse, si nous voulons faire baisser la mortalité en Afrique, il est nécessaire d’avoir une OMS forte, des systèmes de santé primaires robustes, des politiques de santé et des chefs d’État responsables qui dotent leur pays d’un véritable budget de la santé (au moins 15 % du produit intérieur brut).
FF. – En France, faut-il redonner la compétence de la santé aux élus locaux et diminuer le pouvoir des agences régionales de santé ?
PDB. – La politique de santé doit rester de l’ordre national. Si les régions sont en charge des questions de santé, le fossé des inégalités se creusera entre régions riches et régions pauvres, entre milieu rural et milieu urbain. Le ministère de la Santé doit garantir l’égalité des citoyens face à la santé et il est impossible d’autonomiser le système de santé région par région.
En revanche, le système de santé français est trop centralisé, trop bureaucratisé et suradministré. Le système doit être revu dans son ensemble comme lorsque Robert Debré a été chargé par le général de Gaulle de faire les ordonnances de 1958 à l’origine des centres hospitaliers universitaires (CHU). Depuis, les professeurs de santé ont été dotés d’une triple mission : soin, recherche et enseignement. Aujourd’hui, le système s’est affaibli et beaucoup de médecins ne souhaitent plus mener une carrière hospitalo-universitaire et quittent l’hôpital public pour rejoindre des structures privées souvent mieux équipées.
Par ailleurs, les secteurs public et privé ne travaillent pas suffisamment ensemble. Les maires, qui sont présidents du conseil d’administration des hôpitaux, disposent de trop peu de pouvoir. Lorsque les agences régionales de santé (ARS) ont été créées pour enlever aux préfets leurs prérogatives sur la santé, cela a pu avoir un effet bénéfique avec la déconcentration de la santé, mais cela ne fonctionne pas en période de crise. Les préfets sont formés pour représenter l’État et travailler en bonne intelligence avec des élus locaux qu’ils connaissent très bien. Au cours de la crise actuelle, dès que le couple préfet-maire s’est mis en place tout a changé. C’est une leçon à tirer.
Propos recueillis par Élisabeth Cazeaux
_____
1. Philippe Douste-Blazy est alors ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille. (NDLR)
2. Édouard Philippe n’est plus Premier ministre depuis le 3 juillet 2020. (NDLR)
3. Directrice générale de l’OMS de 1998 à 2003. (NDLR)